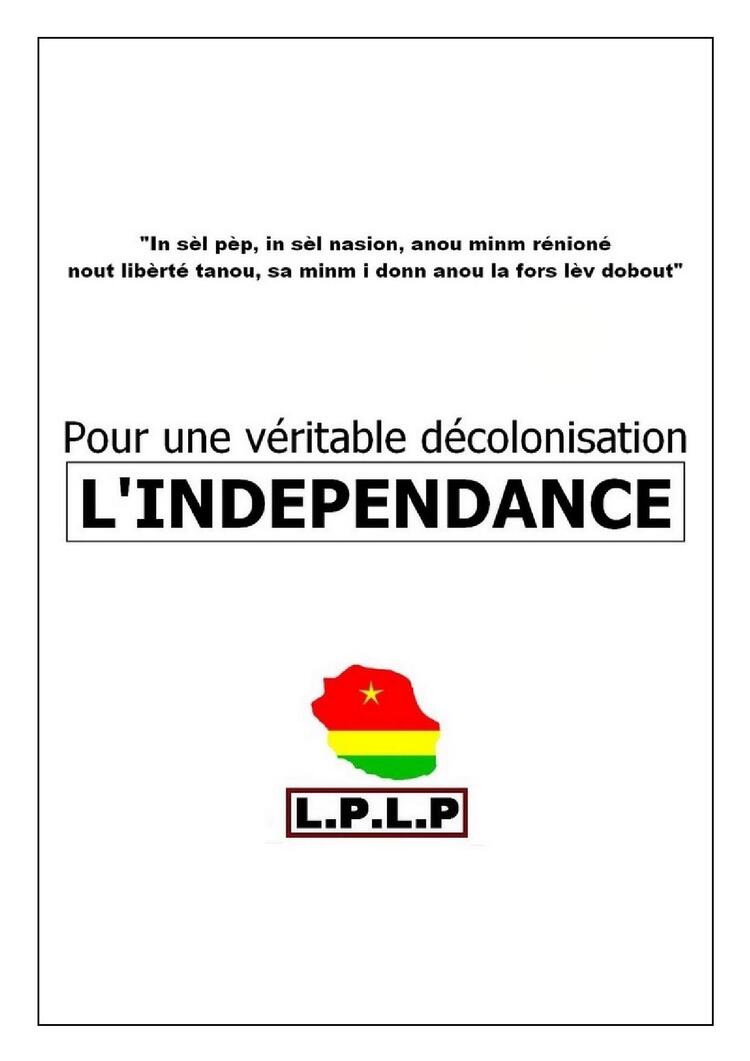-
Par LAGWIYANN NOV dans Un Arrêté du Samedi 14 novembre 2015 autorise l’utilisation d’antidotes injectables contre les neurotoxiques de guerreeil le 30 Novembre 2015 à 11:00
ÉLECTIONS COLONIALES = TRAHISON !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par LAGWIYANN NOV dans Un Arrêté du Samedi 14 novembre 2015 autorise l’utilisation d’antidotes injectables contre les neurotoxiques de guerreeil le 29 Novembre 2015 à 13:16
CONTINENTAL NOTÍCIAS DA SEMANACONTINENTAL NEWS OF THE WEEK
CONTINENTAL NIEUWS VAN DE WEEK
ACTUALITES CONTINENTALES DE LA SEMAINE
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par LAGWIYANN NOV dans Un Arrêté du Samedi 14 novembre 2015 autorise l’utilisation d’antidotes injectables contre les neurotoxiques de guerreeil le 28 Novembre 2015 à 10:20
A La Macarena, des milliers de paysans risquent l’expulsion dans une opération politicienne visant à présenter la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) comme l’un des accapareurs de terres du conflit.
Des rues boueuses, un air poisseux. Situé en pleine bourgade, le modeste aérodrome de La Macarena accueille un impressionnant trafic d’appareils petits porteurs – mais, pour peu qu’il ait plu (et il pleut souvent), « monter » jusqu’ici par l’infâme saignée rebaptisée « route » relève de l’exploit. A proximité de l’inévitable place centrale, le long des petits commerces et des bazars, tricycles motorisés transformés en taxis et motos de faible cylindrée pétaradent sans répit. Harnachés et casqués, équipés de fusils d’assaut, des militaires stationnent aux carrefours ou patrouillent inlassablement. Est-ce un effet de la trêve unilatérale décrétée par la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) pour fluidifier les négociations de paix menées avec le pouvoir, à La Havane, le 20 juillet ? Paraissant s’ennuyer mortellement, les soldats pianotent à n’en plus finir sur leurs téléphones portables pour passer le temps (et ne surveillent pas grand-chose, soit dit en passant).
Ce 18 octobre, dans un charivari de mégaphones et de sono, une foule compacte, joyeuse, transpirante, assiste à la clôture de campagne du Parti libéral (PL) en vue de l’élection des gouverneurs, députés, maires et conseillers municipaux du dimanche suivant.
Toutes les vingt minutes, dans ce « modèle de démocratie » que nul ne songerait à qualifier de « populiste » ou de « clientéliste », comme celui des voisins vénézuélien ou équatorien, un tirage au sort auquel chacun peut participer gratuitement permet aux personnes présentes de gagner des ventilateurs, des brouettes, des batteries de casseroles, des fers à repasser, des téléviseurs, des bicyclettes, un magnifique réfrigérateur (le gros lot), les maintenant en haleine (et sur place !) en attendant le discours de César Sánchez, candidat du PL à la mairie. Lequel, après avoir lui-même remis les cadeaux en demandant aux heureux gagnants « pour qui allez-vous voter ? » dévide le chapelet de promesses qu’on attend de lui. Toutefois, à l’instar de Luis Carlos, aspirant à la fonction de gouverneur du département du Meta pour le Parti social d’unité nationale – dit « parti de la U » (auquel appartient le président Juan Manuel Santos) –, qui l’a précédé la veille, avec les mêmes méthodes, il ne prononce pas un mot sur la préoccupation qui agite et même panique une partie de la population du municipio [1]. A deux cents mètres de là, dressé par les organisations paysannes, un imposant panneau agrémenté d’une carte topographique pose pourtant clairement la question : « Récupération ou expulsion ? »
Panneau installé par les organisations paysannes
Petits cadeaux pour les électeurs du Parti libéral
C’est le 19 mars que l’Institut colombien de développement rural (Incoder) a rendu publique sa « résolution 00810 » : grâce aux informations fournies par les services de renseignements de l’Armée, il va « récupérer » 278 683 hectares de « baldíos » (terres en friche) d’une gigantesque « finca » (propriété rurale) acquise et administrée illégalement par des prête-noms pour le compte des FARC, dans la Serranía (chaîne de montagnes) de La Macarena. Ce qui a permis en chœur aux médias de cracher le même titre spectaculaire : « Les guérilleros sont les plus importants latifundistes du pays ». Un petit chef d’œuvre dans la catégorie « coups fourrés ».
Six mille familles, plus de trente mille personnes sont montrées du doigt (ce qui fait beaucoup de prête-noms !)… « J’ai 49 ans et j’ai vu le jour ici », s’insurge Belio Franco, membre d’une des multiples associations de petits producteurs des « veredas » [2] des environs. « Mes grands-parents étaient propriétaires d’un élevage et il y avait déjà, à l’époque, une grande présence paysanne », gronde pour sa part le dirigeant communautaire Carlos Rodríguez, les lèvres plissées en signe de contrariété. Ce que confirme, mais aussi complète, entre tant d’autres, cette paysanne de la « vereda » El Carmen prénommée Jenny : « J’ai toujours vécu là, mon papa est né ici. Mais ce qui est vrai, c’est qu’on n’a aucun papier. N’importe qui peut arriver et prétendre “ça ne vous appartient pas”. »
Lorsque, en 1953, elles ont surgi sur ce massif au sommet aplati, fuyant l’épouvantable furie de la guerre des conservateurs contre les libéraux demeurée dans l’Histoire sous le nom de « La Violencia » (deux cent mille morts de 1948 à 1954), les familles qui ont fondé La Macarena, sur les rives du río Guayabero, l’ont d’abord appelée « le refuge » – El Refugio. Les FARC, à cette époque, n’existaient pas (elles ne naîtront qu’en 1966). Déplacées des départements du centre du pays par la répression, les vagues de paysans qui arrivent ensuite ouvrent des sentiers, des chemins, déboisent à la machette, créent plus de cent quarante « veredas », tirent de leur terre de quoi ne pas mourir de faim, totalement abandonnés par l’Etat. Il faut attendre les années 1980 pour que la conjoncture devienne soudain plus favorable : hautement « compétitives », indispensables à l’élaboration de la cocaïne, les cultures illicites font leur apparition. Un jackpot (relatif) assuré ! Dans son habitation qui, sans être luxueuse n’a rien de misérable, et où l’on ôte ses bottes boueuses avant d’entrer, Jenny hausse les épaules avec un rire dans les yeux : « Pourquoi vous mentirais-je ? Pendant l’apogée de la coca, beaucoup d’argent est rentré. En vérité, tout ici a été payé par la coca. » Alimentant leurs finances en protégeant les cultures et en taxant le trafic, les FARC, apparues dans les parages à la fin des années 1960, s’y sont alors consolidées.
C’est dans cette région, d’octobre 1998 à février 2002, qu’a été établie la zone « démilitarisée » de 42 000 kilomètres carrés – La Macarena, Uribe, Vista Hermosa, Mesetas (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) –abritant les négociations entre la guérilla et le gouvernement de M. Andrés Pastrana. Récit d’un habitant : « Pendant ces trois années de cohabitation pacifique, sans contrainte, les gens ont fraternisé avec les FARC ; beaucoup de jeunes les ont rejoint ; quand le « despeje » (démilitarisation) s’est terminé, cette population a été exterminée et on a stigmatisé La Macarena en la déclarant pro-guérilla [3]… ». Bien sûr, comme partout dans les zones rurales, des passerelles existent, des connivences, des complicités. Qui ne vomit pas la nature violente et excluante de l’Etat ? Qui n’a pas un frère, un oncle, un cousin dans les rangs des insurgés ? Mais d’autres ne font que supporter leur présence, plus par obligation que par conviction. D’autres encore ne les portent pas dans leur cœur : « En 2002, dénonce un habitant, quand les guérilleros ont dû abandonner la bourgade, ils ont assassiné sept commerçants, raison pour laquelle beaucoup ont la rage après eux. » Sont-ce là les « administrateurs » de la supposée « finca » du mouvement d’opposition armée ?
« D’un côté, réfléchit Rodríguez, lorsque la résolution 00810 nous accuse d’occupation illégale, elle a en partie raison. Il n’y a pas eu d’octroi généralisé de titres de propriété sur tout le territoire du “municipio”. Mais pas parce que les paysans ne les ont pas réclamés : en raison de l’absence totale ou du refus de l’Etat ! » Pour autant, en 1968, l’Institut colombien de réforme agraire (Incora), qui a précédé l’Incoder, a accordé de tels titres, dans la savane du Yarí, dans le sud de la « serranía ». Pour autant, précise le jeune Nicolas Espinoza – cheveux longs, barbiche, surnommé « le prof » par ses compagnons –, « tous les paysans ont un statut légal puisque leurs “veredas” disposent d’une “junta de acción comunal” [comité d’habitants] juridiquement reconnue ; d’une école [mais pas toujours d’un enseignant] ; d’une carte de colon [4], qui a permis à beaucoup d’obtenir des prêts bancaires ; d’un document d’achat-vente pour ceux qui ont acquis leur terre en les rachetant aux fondateurs ; d’urnes apportées par les pouvoirs publics au moment des élections… » Sur ces supposées étendues qu’auraient confisquées la guérilla existe une Zone de réserve paysanne (ZRC) [5] de 88 000 hectares, Pato Balsillas, reconnue par l’Etat ; une autre ZRC en formation, Lozada Guayabero, où le pouvoir et la « communauté internationale » ont investi beaucoup d’argent dans une étude sur la reforestation ; un Parc naturel protégé, Los Picachos, qui ne peut en aucun cas faire partie des « baldíos » (susceptibles d’être octroyés à des sans terre) de la Nation.
Commentant l’ébouriffante nouvelle, le président Santos a pourtant précisé : « En récupérant ces terres en friche, nous allons alimenter la Banque des terres prévue dans le premier point du dialogue [avec les FARC] de la Havane… ». Bel enfumage que de prétendre distribuer des terres aux paysans spoliés par les grands propriétaires en expulsant… d’autres paysans « criminalisés » ! Et évidente « opération psychologique » à destination de l’opinion : faire de la guérilla le plus important « terrateniente » du pays c’est, contre toute évidence, la mettre sur le même plan que l’extrême droite légale (une partie de la classe dominante) et illégale (les paramilitaires), principaux acteurs du déplacement de six millions de personnes, dont 52,2 % ont été dépouillées d’une superficie estimée à 5,5 millions d’hectares, équivalente à 10,8 % de la surface agraire du pays [6].
Contre les allégations de l’Incoder, qui n’a procédé à aucune étude détaillée de la zone, décrite comme une seule « finca », les habitants de la « serranía » se mobilisent. Le pouvoir trouve une parade inattendue (mais qui lui gagnera la « communauté internationale » et ses « écolos » si besoin est) : le 15 septembre, il annonce que quatre « resguardos » [7] vont être constitués pour que ces « terres ancestrales » des Indigènes leur soient remises en propriété. Cette fois, la stupéfaction n’a plus de bornes. Si quelques groupes ethniques vivent effectivement dans la « serranía » – Nasa, Embera chami, Tintigua, Pijao, Guanano, Misak –, ils ne comportent qu’une centaine de familles très majoritairement arrivées elles aussi d’autres zones du pays en tant que colons et entretenant des relations commerciales et sociales normales avec la population métissée, sans aucun conflit.
Présent parmi la grosse centaine de paysans qui bruissent à ses côtés lors d’une « réunion d’information » organisée à La Macarena le 15 octobre, un habitant exprime son inquiétude : « S’il y a expulsion, il y aura une guerre et il y aura des morts ! ». Mal à l’aise, le représentant de l’Incoder, un sous-fifre envoyé au feu par sa hiérarchie, botte en touche : « Je me rends compte qu’il y a une certaine méfiance. On est dans une étape préparatoire, rien n’est décidé. » Plus directe, la fonctionnaire gouvernementale de l’Organisation nationale indigène de Colombie (ONIC), Patricia Tobón, tempère certes en préambule – « Les paysans ont des droits, bien sûr, mais les Indigènes aussi » – , tout en menaçant ensuite implicitement : « Il faut résoudre le problème par le dialogue. Quand ça tourne à la violence, les paysans finissent en prison. »
Pour Carlos Rodríguez, l’explication la plus naturelle est la suivante : « Selon la formule des multinationales, il faut mesurer la densité de population d’une zone où il y a du pétrole avant d’en envisager l’exploitation. Il s’agit donc ici de sortir six mille familles de paysans pour remettre le territoire à une poignée d’Indigènes, qui seront beaucoup plus vulnérables en nombre et en capacité de réaction. Nous, si on reste unis, c’est difficile de nous faire plier. » Si, ces dernières années, un seul puits pétrolier a été perforé dans tout le Caquetá voisin, les multinationales s’apprêtent à bondir, déjà dans les starting block : plus de quarante projets d’exploration concernent la région (dont vingt à San Vicente del Caguán). Un peu plus tard toutefois, le ton montant contre les autochtones et leurs prétendus « territoires ancestraux », Rodríguez interviendra à nouveau : « Attention ! Nous sommes en train de tomber dans le piège qu’on nous a tendu ! Déclencher une guerre de pauvres contres les pauvres… Les Indiens ne sont pas nos ennemis. » Ce que la « personera » de La Macarena – une sorte d’ombuds(wo)man – Eunice Ramírez Yacuma résumera rageusement en conclusion : « A quoi joue le gouvernement ? Il paraît qu’on parle de paix, à La Havane, en ce moment ! » On évoque même, au terme d’un accord passé entre le pouvoir et la guérilla le 23 septembre, une Commission de la vérité… Elle aura du travail, à n’en pas douter.
NOTES
[1] Municipalité et zone rurale, parfois très vastes (« el campo »), qui en dépend.
[2] Hameaux aux habitations parfois très éparpillées.
[3] Dans le cimetière de La Macarena reposent les corps de quatre cents personnes – guérilleros et paysans – enterrées sous le sigle « NN » (non identifiés).
[4] Délivré par la mairie du « municipio » après que la « junta » d’action communale ait certifié qu’il s’agit d’une propriété légale – « sana propiedad ».
[5] Entité juridique définie par la Loi 160 de 1994 et utilisée par les mouvements paysans pour lutter contre la concentration des terres et créer les conditions d’un développement durable tout en assurant la souveraineté alimentaire. S’oppose au modèle agro-exportateur du gouvernement, qui fait tout pour en entraver le développement, et est défendue par les FARC à la table de négociations.
[6] Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo (CEPA), Bogotá, août-décembre 2015.
[7] Réserves sur lesquelles les autochtones exercent une propriété collective et qu’ils gèrent à l’aide d’autorités politiques propres, les « cabildos »
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par LAGWIYANN NOV dans Un Arrêté du Samedi 14 novembre 2015 autorise l’utilisation d’antidotes injectables contre les neurotoxiques de guerreeil le 27 Novembre 2015 à 12:07
Source http://www.cases-rebelles.org/
Z’étoile Imma est professeure à l’Université de Notre Dame (Indiana, Etats-Unis) dans le cadre du programme d’études de genre, sexualités, race, littérature et cinéma africain et afro-diasporique. Elle est aussi poétesse.
Dans cet entretien réalisé en Mai dernier, elle nous parle de deux de ses projets en cours, en résonances profondes . « Our Queer Mandela: Simon Nkoli, the Archive, and the uses of an African Queer » s’attache à rassembler et analyser la production qui s’est faite autour de Simon Nkoli, militant queer anti-apartheid. Et avec « Love Stories from Africa », Z’étoile Imma travaille à montrer comment les thèmes de l’amour et du désir, dans la littérature africaine contemporaine, participent à déconstruire les discours habituels sur les corps africains, les espaces, le genre. Enfin, elle aborde l’importance du travail de Zanele Muholi et en quoi ses travaux photographiques et ses films proposent de nouvelles pratiques de représentation. Cases Rebelles : Peux-tu nous dire qui était Simon Nkoli qui est au cœur de ton projet nommé « Our Queer Mandela: Simon Nkoli, the Archive, and the Uses of an African Queer Icon » ?
Cases Rebelles : Peux-tu nous dire qui était Simon Nkoli qui est au cœur de ton projet nommé « Our Queer Mandela: Simon Nkoli, the Archive, and the Uses of an African Queer Icon » ?Z’étoile Imma : Simon Nkoli était un militant queer qui venait du township de Sebokeng. Il était intéressant à bien des égards. C’était un militant, contre l’Apartheid, un jeune militant dans les années 1980 qui affichait ouvertement sa sexualité. Il a été emprisonné en Afrique du Sud, comme beaucoup de militants. Alors qu’il était en prison, il a révélé son homosexualité à ses co-défendeurs.
Cela a causé pas mal de remous parmi les militants africains qui se trouvaient en prison durant cette période ; ils pensaient que sa sexualité serait utilisée pour délégitimer leurs actions, leur rôle dans la lutte. Mais il a persévéré, et a continué de poser des questions importantes, de pousser les gens à prendre en compte les identités multiples. Donc, il a demandé, disons exigé d’avoir un espace, dans le cadre du mouvement anti-apartheid, en tant qu’homme noir, gay, venant du township.
Ça n’a pas été fait. À l’époque, si vous étiez gay, vous n’en parliez pas. Mais lui, il était décidé à parler ouvertement de sa sexualité dans le contexte de l’apartheid en Afrique du Sud, ce qui l’a amené à être confronté à des tensions problématiques tant dans la communauté gay blanche qui ne voulait pas parler de race, que parmi les militants africains qui ne voulaient pas parler de sexualité.
Donc à bien des égards, il a été, d’une certaine manière, ce militant queer qui a émergé dans les années 80. Il a continué à militer pour les droits des queer en Afrique dans les années 90, jusqu’à sa mort en 1998. Il a été l’une des premières personnes à parler de sa séropositivité. L’une des raisons pour lesquelles le livre s’intitule “Queer Mandela”, en fait, je tire ce titre d’un artiste-performer, Steven Collin qui qualifiait Simon Nkoli de Queer Mandela dans le contexte de l’Afrique du Sud.
En fait, ils avaient des parcours assez similaires – c’est lorsqu’ils étaient de jeunes activistes qu’ils ont été emprisonnés. Après qu’il eut quitté la prison, il a voyagé aux États-Unis, en Europe. Il a créé des alliances, des coalitions avec des gens. Malheureusement, ces gens ne partageaient pas le même intérêt pour l’intersectionnalité, et il retourna en Afrique du Sud pour continuer de militer. Et il était très visible, très public, tant dans les journaux, que dans les émissions radios, ce genre de chose, pour rendre son combat visible.
Jusqu’à présent, sa vie n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie. Les gens parlent de lui en tant que militant queer, les gens le reconnaissent, mais je m’intéresse à la manière dont les médias et les films le représentent, à la manière dont l’industrie de la mémoire le perçoit. Mon intérêt se porte aussi sur les textes qu’il écrivait lorsqu’il était en vie.Et l’une des questions que je me pose avec ce projet est celle de la manière dont son iconographie a été utilisée dans son histoire à lui. Quelles ont été les contributions qu’il a apporté à ce moment précis alors que les gens se posent de plus en plus de questions sur les queers d’Afrique, le mouvement queer en Afrique, l’identité queer, à quoi ressemble la lutte LGBT “globale” qui traverse la diaspora africaine. Des discussions intéressantes se font à l’échelle transnationale. Il était le prédécesseur de ce mouvement actuel, du moment dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui.
 Quelles étaient les raisons qui t’ont poussée à commencer cet autre projet « Love stories from africa« ?
Quelles étaient les raisons qui t’ont poussée à commencer cet autre projet « Love stories from africa« ?Oh, c’est une question géniale… Le projet est toujours en cours, c’est mon second livre en fait. J’écris ces deux livres en même temps, et ils se font écho. Je parlais aussi de cette question de l’amour durant la conférence aujourd’hui, l’amour comme une sorte de moyen de résister à la représentation des femmes et hommes noirEs comme étant trop sauvages pour être capables d’aimer.
Tu sais, j’ai suivi mes études à l’Université en Virginie, la terre de Thomas Jefferson: l’une des chose qu’il disait à propos des noirEs était que nous n’avions pas la capacité d’éprouver des émotions profondes et complexes. Ce fossé vient du fait que les anthropologues allaient en Afrique, voyaient que les hommes épousaient trois femmes, et en concluaient “c’est juste une affaire de famille, juste parce qu’ils ont besoin d’enfants pour travailler dans leur fermes”. Et donc il y avait cette idée que nous ne connaissions pas de romance dans nos relations, que nous n’avions pas de compassion, pas d’amour. La seule forme d’amour dont on parle dans le contexte africain dans les médias c’est l’amour maternel. Mais on ne voit pas l’amour passionnel, érotique abordé largement que ce soit dans les textes critiques ou dans la culture plus populaire, bien que nous ayons des chansons d’amour. Tu sais, cette passion dans les chansons d’amour appartient au contexte culturel du continent africain. Il y a aussi cette manière de voir les noirEs comme des êtres hyper-sexualiséEs ; l’acte sexuel est perçu comme étant animal, il est dépourvu de lien affectif, de questions d’intimité. C’est toujours perçu comme “Oh, vous voulez juste coucher”. Du coup, c’est ça que j’ai envie de bousculer. Tout mon travail… c’est la base de mes recherches universitaires. Et le type d’enseignement que je prône fait partie d’un plus large projet qui vise à humaniser les NoirEs ; qu’il s’agisse de la diaspora sur le continent africain ou les deux et pour réfléchir à la manière dont on questionne, envisage l’intimité comme un outil de résistance ; un projet humanisant pour nous connecter entre nous-mêmes, et le potentiel radical du corps, le corps érotique dans notre communauté. Donc il n’est pas toujours question du regard, celui qui est posé sur nous, qui présume de notre sexualité. Au contraire, il s’agit de comment nous utilisons la sexualité dans nos communautés pour nous exprimer, et exprimer notre amour pour chacunE. Et même tout à l’heure, quand on bavardait, on disait “j’aime touTEs les NoirEs, etc”. Tu vois, c’est le genre de choses qui n’est pas mentionné dans les analyses critiques mais ça existe bel et bien.
Souvent, c’est le genre de choses qui nous propulse, qui nous pousse à faire le travail que nous faisons ; j’aimerais rendre ce genre de choses plus visibles. Il s’agit aussi pour moi de voir comment les producteurs d’événements culturels, qu’ils/elles soient réalisateurICEs, les productreurrICEs d’événements culturels africainEs et féministEs, les écrivainEs, poètes, performeurEUSEs, il s’agit de voir comment ils-elles envisagent l’amour comme un site de résistance. C’est l’objet du projet, et je le vois véritablement en fort écho au projet sur Simon Nkoli, parce que, ce qu’il fait vraiment, c’est parler de la manière dont il aime, la manière dont il est dans l’intimité en tant que queer et l’espace qu’il exige afin de pouvoir en parler. Il refuse de concevoir ça comme un projet déviant.
Tu essaies vraiment de montrer comment le thème de l’amour dans la littérature africaine et l’imagerie questionne la rhétorique qui est habituellement appliquée aux corps africains, leurs sexualités, leur genres.
Exactement, exactement, c’est ce que j’essaie de faire. Je pense à ce moment en particulier, moment de globalisation dans lequel nous nous trouvons actuellement alors que que les mouvements de migration augmentent ; eh bien ces sujets deviennent de plus en plus délicats et complexes parce qu’il existe des discours bien ancrés qui hyper-sexualisent le corps noir. Donc comment interpréter les images érotiques dans ce contexte? De quoi est-il question lorsque l’on parle de l’érotisme ou de la sexualité, de l’intimité dans des espaces où le tourisme du sexe augmente sur le continent africain? Et souvent, le sexe est perçu comme un espace d’exploitation, tu vois. Et c’est comme ça depuis un long moment. Le but pour moi est de suggérer que ces artistes, dans les différentes formes d’art qu’ils pratiquent, sont en fait très au fait de ces tensions, de suggérer qu’ils utilisent l’amour pour contrer ces autres structures qu’elles soient idéologiques, matérielles, les structures économiques de l’exploitation. Ils essayent de nous donner matière à imaginer d’autres façons de penser à la sexualité et la sexualité des NoirEs. D’une certaine manière pour réécrire, non seulement le passé mais aussi imaginer le futur.
Quelles sont les œuvres qui te viennent à l’esprit pour illustrer ce point de vue?
Je pense que le travail de Chimamanda Ngozi Adichie a été vraiment important pour moi. En réfléchissant aux questions autour de l’amour et de l’érotisme, je pense que, dans une large mesure, les écrivaines africaines de cette génération, contemporaine, font des choses vraiment intéressantes. Elles écrivent des scènes d’amour, alors que pour la génération précédente, ou du moins la plus récente, les écrivaines africaines des années 80 et 70, bien souvent la sexualité est un espace d’exploitation où les femmes subissent, il n’y avait pas beaucoup de place pour représenter le plaisir que les femmes africaines ressentent dans le contexte de la sexualité. Tout du moins, s’il en était question c’était implicite, pas explicite.
Des écrivaines comme Chimamanda Ngozi Adichie, Aminatta Forna. Et Mojisola Adebayo et Mamela Nyamza ; leur pièce s’intitule “ I stand corrected”qui parle du viol « correctif » d’une certaine manière. Mais c’est une histoire d’amour entre ces deux femmes qui décident de se marier. C’est très sensuel, très tactile.
J’aimerais parler de quel travail est-ce que cela nécessite de montrer l’amour, de montrer l’amour entre deux femmes, l’amour entre deux femmes noires africaines dans le contexte de la violence sexuelle, et comme moyen de répondre à cette violence sexuelle, la déshumanisation de la subjectivité queer africaine.J’ai parlé à Maaza Mengiste, j’ai aussi écrit sur elle. En fait, je l’ai interviewée l’année dernière, elle disait que son nouveau livre était une histoire d’amour dans le contexte de la guerre. Et j’ai travaillé sur les écrits de Aminatta Forna, une auteure sierra-leonaise qui a écrit “The memory of love”, qui est aussi une histoire d’amour dans le contexte de la guerre. Pourquoi ces auteures écrivent-elles des romances dans un contexte violent? Quel est l’effet? Dans quelle mesure est-ce qu’il s’agit d’une réponse aux histoires de différentes formes de violence oubliées, ou dans le contexte de l’après guerre civile dans le cas de la Sierra Leone, dans “Memory of Love”. Ce sont quelques unes des auteures auxquelles je m’intéresse.
Et bien sûr, le travail de Zanele Muholi a été très important. Ce matin, je parlais de ses photographies, du projet “Faces and Phases”. Mais je m’intéresse vraiment à ses films, qui n’ont jamais fait l’objet d’analyse critique dans la même mesure que ses photographies. Et elle a fait un travail vraiment intéressant, des courts métrages, qui sont en fait des films érotiques de femmes ayant des rapports sexuels. Et une fois encore elle réfléchit à cette question: quelles peuvent être les usages de l’intimité dans le contexte de la déshumanisation de la communauté queer africaine? Je suis vraiment intéressée à m’impliquer dans ces projets. En fait, je viens de voir certaines de ses photographies qui sont exposées ici, on voit clairement la sensualité et l’érotisme dans certains des auto-portraits. Je vais continuer à travailler sur ses travaux, m’engager, et analyser son travail, parce que je pense qu’elle se dirige dans cette direction, loin de cette approche qui se limiterait juste au documentaire, j’emploie “qui se limite” à la légère. Elle réfléchit à la représentation de l’affection, de la sensualité. En même temps, elle garde toujours à l’esprit le contexte de la justice social en Afrique du sud.Tu parlais justement dans ton intervention des pratiques différentes et nouvelles que propose Zanele Muholi…
Je pense que l’une des choses qu’elle entreprend est de nous proposer une pratique de la représentation qui est différente, nous proposer un nouveau langage visuel. Elle est au carrefour de ces différentes formes que sont la photographie coloniale et postcoloniale dans le contexte de l’Afrique du Sud. Je lisais un article de quelqu’un, sur Ota Benga1qui avait été kidnappé. Ces photographies de corps soumis à l’esclavage, corps captifs, évidence de l’ inhumanité des hommes et femmes noirEs, le caractère primitif de notre sauvagerie.
C’est de cette manière, entre autres, que la photographie est devenue un genre. La photographie était utilisé comme un moyen de regarder les autres. C’était un projet visant l’Autre. Je pense qu’elle est vraiment consciente de cet aspect dans la photographie. Elle est aussi consciente de l’histoire récente de l’ Afrique du Sud anti-apartheid, et des artistes engagéEs qui ont utilisé la photographie comme un espace de résistance, pour mobiliser à l’échelle transnationale pour la lutte, et qui ont diffusé ces images. Donc il y a tellement d’histoires auxquelles elle s’intéresse, auxquelles elles donne sens, elles nous amène dans des trajectoires importantes et elle établit des liens entre les moments de luttes passées et la question de la justice sociale pour les sujets queer en Afrique du Sud.
Donc je suis fascinée par la manière dont elle est en conversation avec ces autres formes d’une manière assez fantaisiste et parfois très étrange ; c’est par l’intermédiaire de cette combinaison, intersection qu’elle nous montre une nouvelle route, nous montre le potentiel de la photographie de cinéma en particulier. C’est comme ça que j’envisage sa manière de créer un nouveau langage visuel.
L’une des choses qui m’intéresse toujours, c’est qu’on parle de la photographie, on parle de résistance, d’amour… Ce qui m’intéresse toujours c’est : comment est-ce que tout ça circule? Comment nous, au-delà des frontières, en tant que peuple noir – qu’il s’agisse de la diaspora, des Caraïbes ou de l’Europe et tous ces endroits où nous allons, où nous nous déplaçons, et de plus en plus vers le Moyen Orient et l’Asie, les États-Unis bien entendu… Eh bien, je m’intéresse à la manière dont la culture visuelle représente aussi un espace où nous sommes en conversation l’unE avec l’autre.
De même pour la musique bien entendu qui a servi de socle commun à l’Atlantique Noir, au panafricanisme, aux NoirEs à l’échelle globale, aux afropolitainEs, et il existe d’autres termes. Et je porte toujours un intérêt à déplacer les conversations, donner un espace aux voix africaines dans ces conversations. En tant que personne qui réside aux États-Unis, dont la famille vient des Caraïbes, parfois j’ai l’impression que la conversation est inégale, que les NoirEs venant des États-Unis, de l’Occident pensent qu’ils occupent une position de leader.Cases Rebelles – Novembre 2015
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par LAGWIYANN NOV dans Un Arrêté du Samedi 14 novembre 2015 autorise l’utilisation d’antidotes injectables contre les neurotoxiques de guerreeil le 26 Novembre 2015 à 09:40

Pour le LPLP l'élection du 6 décembre 2015, est une vraie farce coloniale, un vrai "manzé koshon" à laquelle nous ne pouvons pas participer, ni cautionner. Tous ceux qui sont en lice aujourd'hui, mentent aux réunionnais. Ils savent éperduement qu'au lendemain des élections rien ne changera, sinon ceux qui arriveront aux affaires continueront à se remplir les poches.
Le peuple continuera à trimer "po la po patat", à subir le chômage, la vie chère, la misère ... on continuera à envoyer nos jeunes en France ou au Canada. Ils sont tous d'accord avec cette politique, qui ne concours pas au développement économique de notre pays, mais qui nous enmene à toucher encore plus le fond. Avec cette politique coloniale, nous serons toujours à la merci des autres qui ont intérêt - pour garder leurs privilèges - à nous maintenir dans une assistance totale, sous couvert de "solidarité nationale".
Les listes qui se présenteront devant vous, pour réclamer vos suffrages - à droite comme à gauche - vous connaissez leurs incompétences et leurs affairismes. Ils seront là pour se servir et non pour vous servir.
A l'extrême gauche ils sont anticolonialistes, mais ne sont pas de ceux qui combattent le système colonial, leur combat se résume uniquement à une lutte contre le capitalisme.
A l'extrême droite nous connaissons leurs idées xénophobes et ils n'ont pas leur place dans la socièté réunionnaise.
Quant à la seule liste "indépendantiste" nationaliste, présente à ces régionales, après ses amourettes avec les idées du Front National et son positionnement concernant les mahorais de La Réunion, elle s'exclut elle même du combat anticolonialiste et de la lutte pour la libération de notre pays. C'est dans ce contexte, qu'à l'appel du LPLP les indépendantistes et tous ceux et celles qui partagent nos idées"va rès zot kaz lo dimans 6 désanm 2015".
A chaque élection "i viyn fé kroir, i viyn fé pèr, i viyn boush lo zié moun ... kom in sharzèr lo i promèt anou la linn mé rénioné i kroi pi Père Noël tansion pangar kom i di"
La démocratie ne fonctionne plus, aujourd'hui c'est l'abstention qui représente la majorité de la population, mais nos gouvernants, nos élus continuent à faire comme si tout allait bien, comme s'ils étaient toujours les représentants du peuple. Mais
jusqu'à quand ...
Ces élections régionales nous amènent à dénoncer une fois de plus la situation coloniale de notre pays et à appeler les réunionnais à nous rejoindre et à se rassembler pour préparer demain. Au delà de ces élections le combat continu pour une Réunion libre et indépendante au service des réunionnais.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires